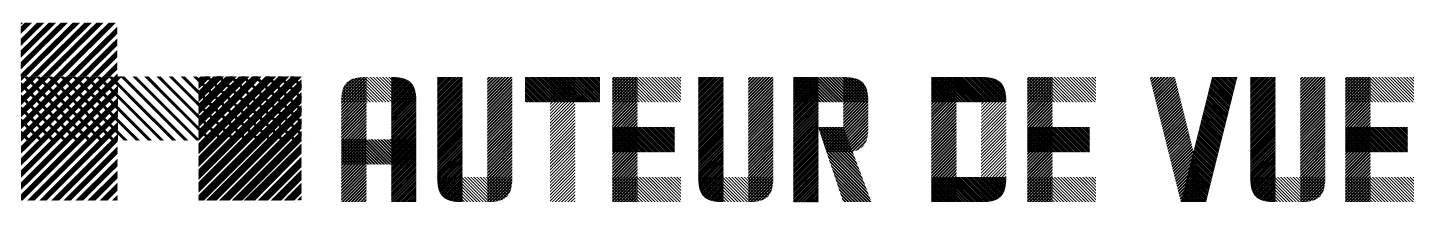
Les élites nécessaires
publié le 17/04/2025

Lumières près du Panthéon-Photographie de l'auteur
L'anti-élitisme est aujourd'hui à la mode. Il constitue en effet l'un des présupposés idéologiques les plus importants des discours politiques contemporains, dans des temps dominés par des institutions de pouvoir détachées du peuple et de ses aspirations. Il est présent en particulier dans les idéologies populistes d'extrême-droite. Il faut faire remarquer à cet égard que l'apparent anti-élitisme de l'extrême-droite n'est pas nouveau: il apparut déjà dans le nazisme et dans les divers fascismes européens du siècle dernier.
Pour ceux-ci, les élites étaient inévitablement associées au pouvoir des sociaux-démocrates, mais aussi bien évidemment à celui des Juifs et des communistes. Il s'agissait alors de rendre ces élites responsables de la décadence politique et morale de l'État ainsi que du déclin social généralisé à l'époque de la Grande Dépression. On peut donc voir que l'anti-élitisme est nécessairement lié à une pensée du déclin, sans laquelle il demeure inopérant.
Une des plus grandes supercheries du fascisme fut précisément de faire croire que la montée au pouvoir de cette idéologie et de ses leaders mettrait fin à l'existence des élites en créant un ordre social basé sur l'uniformité et l'unité sociale parfaite. Le fascisme se présenta ainsi comme un projet égalitaire, ce que les nazis exprimèrent en particulier dans le concept de "communauté du peuple". Dans celle-ci, les distinctions sociales traditionnelles devaient être abolies et remplacées par une conscience forte de la collectivité nationale. L'anti-élitisme, dès lors, impliquait la critique de l'individualisme bourgeois et exigeait de l'homme une soumission totale à l'autorité de l'État.
Pourtant, certaines élites ne furent jamais aussi florissantes que sous le nazisme. Celles qui bénéficièrent le plus de celui-ci furent ainsi les élites économiques, comme le prouvent les profits énormes engrangés par les usines d'armement telles les usines Krupp à l'époque, sous oublier les activités tout aussi lucratives du secteur automobile, vouées en particulier à la construction de véhicules militaires pour le Troisième Reich.
Par opposition, l'élite qui eut le plus à souffrir du nazisme fut l'élite intellectuelle allemande, marxiste ou simplement progressiste. On peut dès lors comprendre que le fascisme engendra une conception perverse de l'anti-élitisme qui visait en fait à renforcer le pouvoir économique du grand capital tout en détruisant toute forme de pensée critique et de contradiction philosophique et idéologique à l'intérieur de la société.
Il en fut de même dans les pays occupés par l'Allemagne nazie, dont la France. Car le grand capital français fut l'un des principaux bénéficiaires de l'Occupation, qui lui permit de s'enrichir considérablement. De L'Oréal à Michelin, ses dirigeants appuyèrent ainsi sans ambiguité la collaboration économique et aussi politique. Les usines françaises tournèrent alors à plein régime dans ces années noires: l'essentiel de leur production permit de soutenir la machine de guerre allemande. Une telle collaboration fut d'ailleurs en grande partie épargnée par les tribunaux de l'épuration, à l'inverse de la collaboration strictement politique.
On retrouve cette conception perverse de l'anti-élitisme dans le néo-fascisme et le populisme d'extrême-droite contemporain. Le nouveau gouvernement américain privilégie ainsi outrageusement les intérêts des multimilliardaires, qui sont d'ailleurs inclus dans l'exercice quotidien du pouvoir. Mais il s'attaque simultanément aux grandes universités et à la recherche scientifique, dont il diminue agressivement les budgets. L'hostilité aux élites se concentre dès lors sur les intellectuels et les chercheurs, soupçonnés de soutenir et de diffuser des idéologies "anti-américaines".
L'anti-humanisme forcené de ce pouvoir mène alors très vite à l'inhumanité. L'opposition à toute forme de savoir conceptuel et spécialisé engendre en effet la célébration de l'ignorance. Celle-ci implique alors le plus souvent l'indifférence au mal et la cruauté. Elle se manifeste en particulier dans la négation du changement climatique, qui provoque pourtant d'innombrables souffrances pour les populations civiles à travers le monde.
L'anti-élitisme officiel des fascistes du siècle dernier et des néofascistes de notre époque ne vise donc qu'à détruire toute forme de diversité d'idées et de pensée à l'intérieur de la société. Au-delà d'un populisme superficiel et vaguement égalitariste, il ne fait en outre qu'accroitre les inégalités socio-économiques de façon vertigineuse. On sait ainsi que le peuple allemand se retrouva profondément démuni et victime de la pauvreté à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L'anti-élitisme des forces et des mouvements progressistes est lui par tradition très différent et même totalement à l'opposé de celui des fascismes et des populismes d'extrême-droite. Les Lumières s'attaquèrent ainsi en premier lieu aux immenses privilèges matériels de la monarchie et de l'aristocratie, dans le but de dénoncer l'injustice sociale profonde qu'ils incarnaient. Ce faisant, ils affirmèrent simultanément l'importance primordiale d'une élite de l'esprit pour l'expression d'un projet révolutionnaire et l'accomplissement futur d'une société démocratique représentative des intérêts du peuple.
Le marxisme et le communisme prolongèrent à leur manière cette critique des élites économiques, représentées selon eux par la bourgeoisie dans la société capitaliste moderne. Tout comme les Lumières, ils affirmèrent la nécessité d'une élite intellectuelle, essentiellement celle des philosophes, capable de souligner la signification politique d'une lutte des classes populaires contre leurs exploiteurs.
Malheureusement, il faut bien reconnaitre que dans le monde actuel, la conception réactionnaire et même fasciste de l'anti-élitisme l'emporte trop souvent sur son pendant de gauche. La souveraineté absolue des perspectives économiques et financières imposée par les pouvoirs mondialistes néolibéraux se retrouve en ce sens dans les populismes d'extrême-droite actuels, au-dela d'une apparente contradiction bien illusoire.
Dans cette optique, l'anti-élitisme est devenu aujourd'hui à bien des égards suspect. Il entretient en permanence une confusion inextricable. Le peuple ne sort jamais vainqueur de cet anti-élitisme-là. Il demeure en effet confronté à son aliénation et à ses épreuves quotidiennes, en dépit des discours démagogiques qui lui promettent des lendemains qui chantent.
Il ne faut dès lors pas rejeter complètement la notion d'élite, mais plutôt la réhabiliter et valoriser à bien des égards son identité intellectuelle et culturelle. La démocratie grecque de l'Antiquité, modèle politique et historique égalitaire si l'en est, reposa dans cette optique sur la prééminence des penseurs, des hommes de science et des artistes, auxquels elle accorda un statut privilégié.
Parallèlement, la France des Trente Glorieuses ne fut pas synonyme de développement et de croissance exceptionnelle pour de simples raisons économiques. Elle constitua en effet simultanément une période de grande fécondité intellectuelle, si l'on songe en particulier au rôle de premier plan que les existentialistes jouèrent dans la culture française de l'époque.
En d'autres termes, la notion d'élite ne contredit pas fondamentalement la notion d'égalité. Au contraire, ce sont les élites de la pensée, des Lumières à Marx, qui furent les plus ardents défenseurs de cette dernière. À l'anti-élitisme radicalement inégalitaire des extrêmes-droites populistes et des néofascismes, il faut alors répondre aujourd'hui par un élitisme réellement égalitaire, qui fut depuis toujours en Occident celui des hommes et des femmes épris de liberté et de progrès social.
L'élitisme peut donc bel et bien être révolutionnaire. La révolution de 1789, ainsi, eut besoin de la caste fermée des Jacobins pour réaliser son projet. De la même manière, la Révolution russe de 1917 ne put s'accomplir que grâce à l'action d'un leader comme Lénine qui était aussi un penseur majeur issu du marxisme.
Il ne s'agit pas de rêver d'une société sans distinctions ni classes sociales, car de tels rêves, dans l'histoire, n'ont connu que des échecs retentissants. Mais il s'avère néanmoins nécessaire de dénoncer avec force une définition des élites issue uniquement du pouvoir de l'argent. Une telle définition mène inévitablement en effet à la mort des valeurs et des idéaux démocratiques.
+ de décryptages du même auteur
Site développé par Polara Studio
