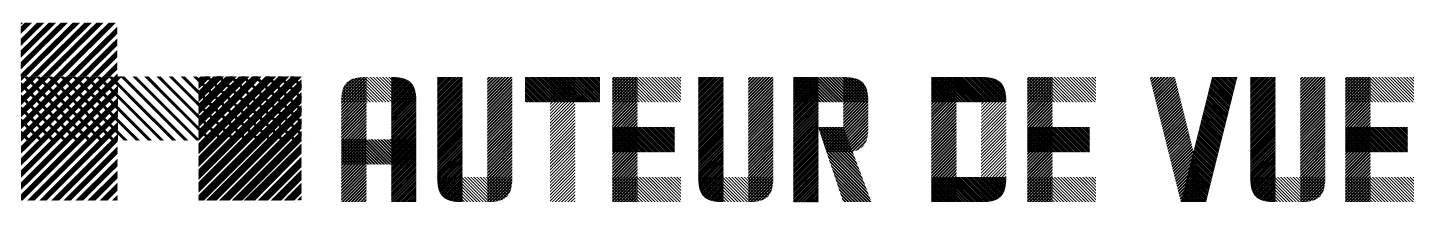
Au cœur de Navalny : phénoménologie, médecine, politique
publié le 24/03/2025

2016 (Getty Images) Eruption d'un volcan russe au Kamchatka.
Au-delà de ses complexités théoriques husserliennes, la phénoménologie serait aussi une certaine ambiance, fertile, en vue de l’énonciation d’une parole accordée aux signes insignes du monde. S’acheminer vers cette parole portant sur de telles manifestations implique nécessairement un potentiel d’unification du divers sensible, c’est-à-dire de fédération de des hétérogénéités résultant de l’arrachement de certains signes à la matrice de l’Histoire.
Les gens illustres semblent pouvoir contribuer à cette nécessité par leur statut de trait d’union entre singularité et historicité. Lorsque le signe choisit le terrain de la sémiologie médicale, par définition enracinée dans la physiopathologie, l’ambition de relever le défi de l’arrimage, dans le respect de son autonomie subjective, d’une parole phénoménologique à l’objectivité des symptômes n’est pas mince. Cette ambition implique de demeurer d’un côté fermement attaché à la libre raison humaine, entendue comme sensibilité accomplie et cependant non effondrée en elle-même, tout en l’immergeant d’un autre côté dans la turbidité jaillissante de la symptomatologie. Soutenir cette tension peut, à l’inverse, aussi impliquer d’extraire le symptôme pathologique de ces lieux épaissis et de l’assécher à la lumière du regard du phénoménologue.
La phénoménologie apparaît alors comme un cadre autorisant un regard soucieux de l’assomption du concept, compris de manière hégélienne, inhérent à une personne, sans prétention à une universalité possible au-delà de celle-ci. Ainsi, l’universel épouse, plus qu’il ne s’effondre sur lui, le particulier, l’élevant alors au singulier. Fond alors sur le débat l’implacable sentence freudienne selon laquelle la société n’est rien, et que le sujet de l’individuel, ruinant toute perspective cosmopolitique à une phénoménologie de la singularité médicale.
Dépasser dans ces conditions l’antagonisme irréfragable entre la prévalence d’un symptôme et le particularisme de l’individu qui le produit pour conférer une puissance herméneutique de magnitude sociétale à l’intuition vivifiée par le regard phénoménologique implique de nourrir l’audace d’interpréter les évènements pathologiques derniers des grandes figures de ce monde avec une rigueur non dénuée de respect ni de liberté interprétative. La définition la plus fraîche de la phénoménologie, ainsi que sa neutralité subjective, l’appréciable simple retour aux choses mêmes, retrouve alors sa place dans cette activité de subversion des évidences.
La figure de Navalny est intéressante et propice à notre proposition. Il est opportun de rappeler que, selon l’exigence de l’époque, la fin extrême de sa destinée nous échappe pour des raisons politiques. En réalité, le voilement exprès de cette fin n’est même en rien voilé derrière une autre fin supposément officielle. Il nous est intimé par les Autorités que le mystère doit demeurer le leur, et qu’en cela, il ne saurait nous en être fait cadeau, comme ce peut être le cas dans le domaine religieux par exemple. Ce mystère sans indice nous est imposé, et en cela confisqué. La grammaire de la dialecticité du monde, monde que nous partageons de nouveau avec les Empires, nous laisse cependant une chance. Un mystère bâillonné confisque, abrase, et provoque le cri de sa cause. Il s’agit alors d’un cri silencieux, qui accomplit la parole de Jean Tardieu, dans les Dieux étouffés : Puisque les morts ne peuvent plus se taire, est-ce aux vivants à garder leur silence ?Réaccéder à ce silence implique de circonscrire un destin, de lui assigner un lieu. Dans le documentaire Vivre et encore plus consacré à Pasolini, il est proposé que la mort d’un poète constitue un destin. Pasolini surenchérit, bien sûr, en proclamant que seule la mort permet aux hommes de connaître effectivement le défunt ; que c’est par le type même de mort vécue et la limite que celle-ci impose à la forme existentielle infinie, ainsi devenue finie, que ce défunt acquiert, aux yeux de son monde alors devenu enfin spectateur, sa figure, autorisant un vis-à-vis silencieux, une rencontre.
De ce point de vue, les destins deviennent, dans leurs derniers instants, dissimulateurs ou dévoilants. Staline décède semble-t-il assez paisiblement dans son lit. A Prague ou à Tunis, Jan Palach ou Mohammed Bouazizi se transforment en concept historique en s’abolissant par le feu, en tant qu’acte total, et déclenchent une révolution. Mais ces destins sont aussi, conformément aux vœux des Empires, souvent négligés, où la passivité attendue du regard dissout les derniers actes des figures historiques dans un flasque infini.
La figure de Navalny est, disions-nous, propice. Le regard bleu acéré, dont certains pourraient être convaincus qu’il éclaire lui-même la nuit, semble traverser notre monde et ses opacités tout en se nourrissant lui-même du sombre. Au soir boréal de sa vie, cette lumière, à la fois illuminante et peut-être illuminée, si jamais on la considère comme la cause de ce destin, a semble-t-il librement opté pour son propre étouffement. Navalny a évidemment misé sur l’éventualité selon laquelle son extinction ne pourrait, selon la loi platonicienne fondamentale, que magnifier l’Idée dont il était la manifestation sensible. Sans s’aventurer dans une phénoménologie de la lumière, disons simplement, qu’invisible en elle-même, suprasensible dans son intimité – la dualité onde-corpuscule le rappelant expressément, la lumière se sacrifie dans son interaction avec la matière pour accorder à cette dernière ses propriétés sensibles, son existence en somme.
Dans la tradition théologique, la lumière est à la fois à l’aurore et à la fin du processus d’infiltration de la conscience dans le monde naturel. La lumière ouvre un devenir à même la stase, mais elle manifeste également la possibilité d’intelligibilité maximale de la conscience. L’intérêt de Descartes pour la lumière en tant que servante didactique du rationalisme subjectif le confirme.
Comment alors, en physiologie, lier la lumière à l’acte ? Le système cardiaque unifie de manière rythmique, sinusoïdale, sinusale comme employé en cardiologie, le sang social, spéculatif, existentiel, plus clair (bien sûr métaphoriquement) du haut du corps, avec le sang profond, actant, métabolique, finalement aussi un peu aveugle, plus sombre, du bas du corps. Ces notions ne sont pas positivistes mais leur logique demeure. L’intégralité de ce mouvement physiologique, de ce geste, pourrait-on dire, proche celui de Geist allemand, qui signifie esprit, c’est-à-dire ce qui lie le monde à lui-même, est oscillatoire, contradictoire, puisque l’orientation de chaque point d’une sinusoïde est entravée par son contraire futur, paradoxe par essence. En systole, le volume intracardiaque, récapitulation psychocorporelle de toute la vie antérieure, se voit projeté de manière divergente et pourtant in fine fédérative, vers, à la fois, une nouvelle pensée possible, et un nouvel acte simultanément possible. En diastole, les conséquences physiologiquement reçues du rapport du sujet à l’arène phénoménologiquement reçue du monde sensible, ainsi que de la pensée qui s’y oppose dialectiquement, sont accueillies puis unifiées.
Ce tableau cède-lui-même à une certaine catégorisation actionnelle et réactionnelle des deux grands mouvements de la physiologie cardiaque pour des raisons liées au format de ce texte. Si le lecteur accepte néanmoins cette finitude ici-même, il pourra, comme le rédacteur, méditer la question suivante en apparence très inactuelle, et les sentences qui en découlent : Navalny fut-il victime, ou alors acteur, d’une mort diastolique ou systolique ? Dans le premier cas, son corps, infiltré par la coercition et le non-sens, lui fit, bel et bien, rendre l’âme, comme l’on dit. Navalny était évidemment et quasi-exclusivement politique. Dans le second cas, une systole en tant que dernier acte politique fantasmé, anticipé par une pensée ayant déclenché cette éjection cardiaque finalement vaine étant donnée l’impossibilité de son effectuation, aurait constitué son testament véritable sous forme d'un rappel fondamental : la vie de l'esprit éthique peut parfois impliquer la mort dans l’acte.
Dans ce polar médico-politique, le cœur du rédacteur balance ici en faveur d’une systole. On pourrait alors assimiler cette systole, cette éjection sans retour, à un don de sang d’un type prototypique, destiné à un grand malade politique : le meilleur patient de Navalny, bien connu
+ de décryptages du même auteur
Site développé par Polara Studio
