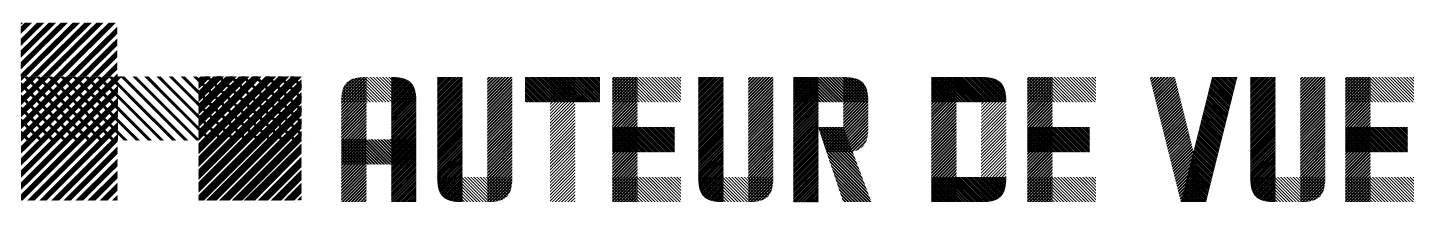
Le serment trahi : pouvoir, promesse et oubli du peuple
publié le 29/12/2025

Vecteezy
« Que le peuple me retire sa confiance, que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment » (Art. 50 de la constitution ivoirienne). Cette phrase, souvent entendue dans les discours d’investiture des chefs d’État, résonne comme une promesse solennelle, une alliance sacrée entre le gouvernant et le peuple. Elle est censée incarner le fondement éthique du pouvoir, l’expression d’un engagement à servir la nation avec loyauté, intégrité et justice. Pourtant, en Côte d’Ivoire comme dans bien d’autres pays, cette déclaration semble de plus en plus relever du rite creux que de la conviction intérieure. Le serment présidentiel, tel qu’il est formulé, engage non seulement la conscience personnelle, mais aussi la responsabilité politique et juridique. Il lie le chef de l’État à l’idéal républicain, à la Constitution, et à ce peuple dont il prétend incarner la volonté. Mais la question se pose avec acuité : les présidents y croient-ils encore vraiment ? Et surtout, sont-ils prêts à en assumer les conséquences, à savoir perdre la confiance du peuple et répondre devant la loi s’ils trahissent leur mandat ?
Le serment du chef de l’État, en Côte d’Ivoire, est prévu par la Constitution. Lors de son investiture, le président déclare devant la Nation qu’il respectera la Constitution, qu’il défendra l’intégrité du territoire, qu’il œuvrera pour le bien-être des Ivoiriens. Il s’agit donc d’un acte fort, à la fois politique et symbolique, qui engage la parole donnée et consacre un lien de confiance. Mais cette confiance peut-elle exister durablement lorsque les institutions sont faibles, la justice dépendante, et la société civile muselée ? La Côte d’Ivoire, depuis son indépendance, a connu une histoire politique tourmentée, marquée par des coups d’État, des crises post-électorales sanglantes, des violences politiques et une succession de présidences contestées. Dans ce contexte, le serment présidentiel semble souvent vidé de sa substance, réduit à une formalité protocoliaire, déconnectée des exigences démocratiques.
Or, le respect du serment présidentiel suppose d’abord un certain rapport à l’éthique. Un président qui trahit son engagement, qui gouverne pour un clan, qui viole les libertés publiques ou manipule les institutions à son avantage, trahit non seulement sa parole, mais l’esprit même de la République. La Côte d’Ivoire a connu ces dernières décennies plusieurs moments où le peuple aurait pu, aurait dû, retirer sa confiance. Mais le système institutionnel verrouillé, la peur, la répression, le clientélisme et la confiscation de la parole publique ont souvent empêché l’expression libre de cette défiance populaire. À quoi bon proclamer que le peuple peut retirer sa confiance, si dans les faits, aucun mécanisme juridique ou institutionnel ne permet une telle destitution effective ?
Il y a dans cette phrase une dimension de responsabilité personnelle qui interpelle : « que je subisse la rigueur des lois ». Elle pose la présomption d’un président justiciable, d’un homme parmi les hommes, tenu de répondre de ses actes. Mais cette présomption est contredite par les faits : dans la pratique, les présidents bénéficient d’une immunité quasi-totale pendant leur mandat, et même après, ils sont rarement inquiétés. L’histoire récente de la Côte d’Ivoire en témoigne : les épisodes de violences postélectorales, les détournements de fonds publics, les décisions politiques controversées ou autoritaires n’ont que très rarement conduit à des poursuites judiciaires, et encore moins à des condamnations. La justice semble hésitante, timorée, ou soumise. Ainsi, l’idée même de « subir la rigueur des lois » devient un vœu pieux, une illusion démocratique sans prise réelle sur le pouvoir.
Mais alors, pourquoi les présidents continuent-ils de prêter serment avec autant de solennité ? Est-ce pour sauver les apparences, pour légitimer leur pouvoir aux yeux de la communauté internationale, ou pour apaiser temporairement les consciences citoyennes ? Il est fort probable que le serment soit perçu par beaucoup comme une scène de théâtre politique, où le langage symbolique est utilisé pour masquer la réalité du pouvoir. Car dans les faits, ce pouvoir est souvent exercé de manière autoritaire, personnalisée, patrimoniale. Le président est parfois perçu non comme le garant des institutions, mais comme leur incarnation absolue. Dans une telle logique, toute remise en cause de son action est assimilée à une attaque contre l’État lui-même. Le lien de confiance se transforme alors en allégeance, et la politique en culte de la personnalité.
Pourtant, il serait injuste de dire que tous les présidents ignorent sciemment la portée de leur serment. Certains, peut-être, y croient réellement, du moins au début de leur mandat. Il est possible qu’au moment de leur investiture, ils soient sincèrement animés par le désir de servir leur pays, d’agir dans l’intérêt général. Mais les logiques du pouvoir, les pressions politiques, les rivalités internes, les tentations autoritaires, et les compromissions successives finissent souvent par éroder cette sincérité initiale. Le serment devient alors un souvenir gênant, un engagement trahi que l’on préfère oublier ou maquiller sous les discours triomphalistes.
Dans le cas spécifique de la Côte d’Ivoire, cette question prend une acuité particulière. Le pays sort à peine de décennies de fractures profondes, de tensions identitaires, de violences électorales. La défiance envers les institutions est encore forte, et le sentiment d’un pouvoir éloigné des réalités quotidiennes est largement partagé. Dans ce contexte, le serment présidentiel devrait être un moment de refondation du pacte social, une promesse de rupture avec les pratiques anciennes. Il devrait être un appel au peuple à exercer une vigilance citoyenne, à demander des comptes, à participer activement à la vie démocratique. Mais cela suppose un État de droit effectif, une justice indépendante, une société civile forte, et une presse libre. Or, dans un environnement marqué par la concentration des pouvoirs, la judiciarisation sélective de l’adversaire politique, et l’absence de culture démocratique enracinée, ce serment reste sans effets.
Peut-on alors penser à des mécanismes concrets qui permettraient de rendre effectif cet engagement présidentiel ? Certains pays ont inscrit dans leur Constitution des procédures de destitution du président en cas de haute trahison ou de manquement grave à ses devoirs. D’autres ont mis en place des cours spéciales, des juridictions constitutionnelles fortes, ou des commissions parlementaires de contrôle. En Côte d’Ivoire, de telles procédures existent en théorie, mais leur mise en œuvre reste marginale, voire inexistante. La culture du consensus de façade, la peur du chaos, la personnalisation du pouvoir freinent l’émergence de véritables contre-pouvoirs. Le peuple, quant à lui, n’a que le vote comme moyen d’expression directe. Mais ce vote est souvent piégé : soit par la fraude, soit par l’absence d’alternatives crédibles, soit par la violence qui entoure les élections.
Il est donc urgent de repenser les conditions d’exercice du pouvoir, de redonner sens au serment présidentiel. Cela passe par une réforme en profondeur des institutions, mais aussi par une éducation citoyenne renforcée. Le peuple doit être outillé pour exercer une veille critique, pour demander des comptes, pour sanctionner, par la voie légale, les manquements graves. Le président, lui, doit comprendre que son autorité ne découle pas de son charisme personnel, ni de sa capacité à se maintenir au pouvoir, mais de sa fidélité au contrat républicain. S’il trahit ce contrat, il doit être démis et jugé.
Il est tout aussi important que les élites politiques, les intellectuels, les journalistes, les religieux et les acteurs sociaux s’engagent dans cette vigilance démocratique. Le serment présidentiel ne doit pas rester un moment figé, un rituel sans lendemain. Il doit devenir un repère permanent, une boussole éthique à laquelle on revient sans cesse pour évaluer l’action publique. Cela suppose une mémoire collective vive, une exigence morale partagée, et une capacité à transformer l’indignation en action politique. Ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra faire de la phrase « Que le peuple me retire sa confiance… » autre chose qu’une formule creuse.
En définitive, poser la question « est-ce que les présidents le savent ? » revient à interroger non seulement leur conscience personnelle, mais aussi notre capacité collective à les y contraindre. Car si un président oublie ou méprise son serment, c’est souvent parce qu’il sent qu’il n’en paiera pas le prix. Là réside notre responsabilité. La démocratie n’est pas un système fondé sur la seule vertu des dirigeants, mais sur l’équilibre des pouvoirs, le contrôle citoyen, et la force du droit. Que le peuple puisse retirer sa confiance, non par la rue et la violence, mais par des institutions fortes, des médias libres, et des élections transparentes. Que les présidents sachent qu’ils ne sont pas au-dessus des lois. Et surtout, qu’ils soient prêts, le jour venu, à répondre de leurs actes. Car gouverner, ce n’est pas dominer : c’est servir, et rendre compte.
+ de décryptages du même auteur
Site développé par Polara Studio
