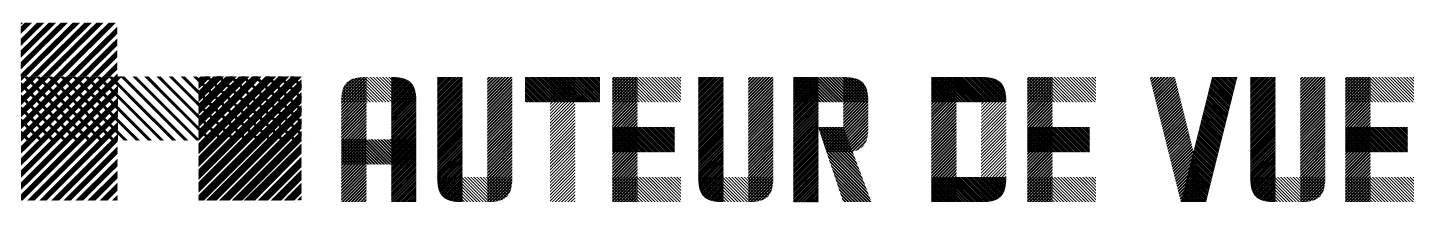
La crèche de Noël chez Spinoza : une fête sans transcendance
publié le 23/12/2025

Nativité de Jésus
La crèche de Noël occupe, dans l’imaginaire chrétien, une place singulière : elle donne à voir l’événement fondateur de l’Incarnation sous une forme humble, familière et presque domestique. L’enfant, la mère, le père, les bergers, les animaux, tout concourt à produire une scène de proximité, de douceur et de reconnaissance affective. Pourtant, cette représentation est indissociable d’une affirmation métaphysique forte : Dieu s’y donne comme transcendant devenu immanent, comme infini entrant dans la finitude humaine. Or, une telle affirmation est radicalement étrangère à la philosophie de Spinoza. Penser la crèche de Noël à partir de Spinoza revient donc à opérer un déplacement critique : que reste-t-il de cette fête si l’on renonce à la transcendance, à l’Incarnation et à toute lecture théologique du salut ? Peut-on encore parler de Noël lorsque Dieu n’est plus un être personnel, libre de s’incarner, mais la substance unique de la nature ?
La philosophie spinoziste se construit précisément contre toute représentation anthropomorphique de Dieu. Dans l’Éthique, Dieu n’est ni un souverain, ni un père, ni un juge, encore moins un être qui intervient dans l’histoire humaine pour y accomplir un dessein providentiel. Dieu est la substance absolument infinie, cause immanente de toutes choses, identique à la nature elle-même (Deus sive Natura). Dès lors, l’idée même d’une naissance de Dieu dans le temps est dépourvue de sens. Dieu n’entre pas dans l’histoire ; il est la condition éternelle de tout ce qui existe. La crèche, comprise comme lieu de l’Incarnation, devient ainsi philosophiquement impossible dans un cadre spinoziste.
Cependant, cette impossibilité ne condamne pas nécessairement la fête de Noël à l’insignifiance. Elle invite au contraire à une relecture immanente de ses symboles. Car ce que Spinoza combat, ce n’est pas la joie, ni la communauté, ni les affects positifs associés aux fêtes religieuses ; c’est l’illusion théologique qui consiste à projeter sur Dieu des intentions humaines et à fonder la morale sur l’obéissance à une volonté transcendante. Noël, débarrassé de cette illusion, peut être compris autrement : non plus comme la célébration d’un miracle surnaturel, mais comme une mise en scène collective de valeurs humaines fondamentales.
La crèche, dans cette perspective, ne représente plus Dieu fait homme, mais l’homme dans sa condition la plus élémentaire : la naissance, la dépendance, la vulnérabilité. L’enfant n’est plus le Fils de Dieu ; il est la figure universelle de la vie qui commence, de la puissance d’exister encore fragile. Or, pour Spinoza, toute chose s’efforce de persévérer dans son être (conatus). La naissance est précisément le moment où ce conatus apparaît dans sa forme la plus nue, encore exposée aux causes extérieures. La crèche devient alors une scène de l’immanence vitale : non pas l’irruption de l’infini dans le fini, mais l’expression d’une puissance naturelle qui s’actualise dans un corps singulier.
De même, les figures qui entourent l’enfant – Marie, Joseph, les bergers – cessent d’être des personnages sacrés pour devenir des figures relationnelles. Elles expriment la dépendance réciproque des individus, leur inscription dans un réseau de causes et d’affects. Chez Spinoza, nul individu ne se suffit à lui-même : chacun existe par et avec les autres. La crèche, relue à cette lumière, donne à voir une communauté minimale fondée sur le soin, la protection et la coopération. Ce n’est pas l’amour divin qui sauve l’homme, mais la capacité humaine à produire des affects joyeux communs.
La joie occupe, en effet, une place centrale dans l’éthique spinoziste. Elle est définie comme le passage d’une moindre à une plus grande perfection, c’est-à-dire comme une augmentation de la puissance d’agir. Or, Noël est universellement associé à des pratiques joyeuses : rassemblement, don, partage, chants, repas communs. Ces pratiques n’ont nul besoin d’être justifiées par une théologie du salut. Elles trouvent leur légitimité dans leurs effets : elles augmentent la puissance collective, renforcent les liens sociaux et produisent un sentiment d’appartenance. La fête de Noël, comprise spinozistement, devient ainsi une technologie sociale de la joie.
Cette relecture permet également de désacraliser la morale associée à Noël. Dans la tradition chrétienne, la crèche est souvent mobilisée pour appeler à l’humilité, à la charité et à l’obéissance à l’ordre divin. Chez Spinoza, au contraire, la morale ne repose ni sur l’humilité ni sur le renoncement. L’humilité est un affect triste, né de l’ignorance de sa propre puissance. La véritable éthique consiste à comprendre les causes de nos affects afin d’orienter notre désir vers ce qui augmente réellement notre puissance d’agir. La générosité et la bienveillance, souvent exaltées à Noël, ne sont pas des vertus parce que Dieu les commande, mais parce qu’elles sont rationnellement utiles à la vie commune.
Dans cette perspective, la crèche peut être comprise comme une pédagogie affective. Elle émeut, touche, attendrit, et par là dispose les individus à des comportements coopératifs. Spinoza reconnaît pleinement le rôle de l’imagination dans la vie sociale. Les images, les récits et les symboles ont une efficacité politique et morale, même lorsqu’ils ne reposent pas sur une vérité métaphysique. La crèche relève de ce registre : elle n’enseigne pas une vérité philosophique, mais elle produit des affects socialement utiles. Le philosophe n’a donc pas à la détruire, mais à en comprendre la fonction.
Cette approche permet également de penser Noël comme une fête sans culpabilité métaphysique. Le christianisme traditionnel associe la naissance du Christ à la rédemption du péché originel. La crèche rappelle que l’homme est sauvé parce que Dieu s’est fait homme. Spinoza, en revanche, rejette toute doctrine du péché. L’homme n’est ni coupable ni déchu ; il est un être naturel soumis aux mêmes lois que le reste de la nature. Noël, dès lors, ne commémore pas une faute réparée, mais célèbre simplement l’existence elle-même, dans sa fragilité et sa puissance.
Il en résulte une transformation profonde du sens de la fête. Noël n’est plus l’attente d’un salut venu d’ailleurs, mais l’affirmation immanente de la vie commune. La crèche n’est plus le seuil du ciel sur la terre, mais une scène terrestre par excellence, où se manifeste ce que Spinoza appelle la communis utilitas, l’utilité commune. Ce déplacement a également une portée politique. Spinoza montre que les religions, lorsqu’elles se fondent sur la peur et l’espérance, deviennent des instruments de domination. Mais lorsqu’elles favorisent la paix, la solidarité et la joie, elles peuvent être tolérées, voire intégrées à la vie civile. Une crèche sans transcendance échappe aux dérives théocratiques : elle ne commande pas, elle rassemble.
Enfin, penser la crèche de Noël chez Spinoza, c’est accepter une certaine désenchantement du monde religieux, mais sans sombrer dans le nihilisme. La disparition de la transcendance ne signifie pas la perte du sens, mais sa redistribution. Le sens n’est plus donné par un événement surnaturel ; il est produit par les pratiques humaines elles-mêmes. Noël devient alors une fête de l’immanence, une célébration de la capacité humaine à instituer des moments de joie partagée dans un monde sans finalité extérieure.
Ainsi comprise, la crèche de Noël n’est pas incompatible avec la philosophie spinoziste, à condition de renoncer à ce qui en constituait le noyau théologique. Elle cesse d’être le symbole d’un Dieu qui descend vers l’homme, pour devenir celui d’hommes qui, par l’imagination et l’affect, cherchent à augmenter ensemble leur puissance de vivre. Noël, chez Spinoza, n’est plus une promesse de salut ; il est une expérience de joie rationnellement explicable, socialement féconde et philosophiquement assumable.
+ de décryptages du même auteur
Site développé par Polara Studio
