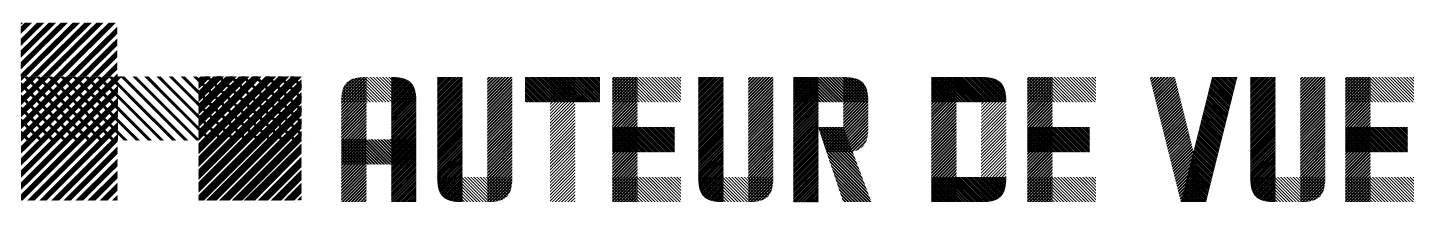
L'objet culte en catastrophe
publié le 27/09/2019

Creative Commons (flickr.com)/ Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, "Casablanca", 1942
Arkadi et Boris Strougatski ont publié en 1972 un roman de science-fiction, Pique-nique au bord du chemin, dont le héros devenu culte, le stalker, est une sorte de guide évoluant dans une zone rendue dangereuse pour l’homme par les déchets qu’y auraient laissés des extraterrestres. Ni les auteurs du roman, ni Andreï Tarkovski dans la version cinématographique qu’il en a proposée en 1979, ne pouvaient alors se douter que ce personnage allait servir de modèle pour une contre-culture ukrainienne traumatisée par l’accident nucléaire de 1986 à Tchernobyl. La protestation adolescente de cette contre-culture, qui s’exprime par l’occupation illégale de la zone radioactive, est toutefois aujourd’hui noyée dans la masse des touristes toujours plus nombreux qui visitent les environs de la centrale en pensant entrer dans un film (« Où sont les mutants ? »). Tourisme noir où le cultisme montre son autre visage : celui de la parodie. Si le stalker doit surtout sa popularité au roman et aux jeux vidéo qui s’en sont inspirés, c’est sans doute Tarkovski qui a saisi l’essence tragique du personnage, en en faisant un Christ moderne à la recherche d’une nouvelle forme de sacré à partager.
« Dans l’espace de la culture populaire et médiatique, le mot « culte » a aujourd’hui pris le relais des catégories esthétiques traditionnelles. […] le culte a envahi tous les domaines, du cinéma à la musique, du livre à la télévision » : ce constat que faisait Philippe Le Guern en 2002 est plus que jamais actuel. Mais pour éviter que l’objet culte ne devienne insaisissable, il apparaît nécessaire de continuer à le penser de l’intérieur, en poursuivant le geste inaugural d’Umberto Eco. Qu’est-ce qui définit ces films culte qui attirent un public fervent, parfois marginal, ou qui du moins se reconnaît comme élu par eux ? À cette question, Eco a jadis (1985) proposé une réponse brillante quoique incomplète. Un film culte, disait-il, est un collage de stéréotypes du cinéma populaire : des personnages et des situations comme on en a vu cent fois, mais assemblés avec une si franche naïveté ou avec un tel goût ironique de l’excès qu’ils atteignent une forme de sublime, qu’ils en viennent à susciter chez les spectateurs une sorte d’ivresse.
De l’exemple choisi, Casablanca de Michael Curtiz (1942), Eco énumérait les clichés : le résistant héroïque, la femme dévouée, l’ancien amant cynique seulement en apparence, leur rencontre entre intrigues policière et amoureuse… Mais il échouait probablement à en saisir jusqu’au bout l’élément culte, faute de tirer toutes les conclusions de sa théorie : si le film culte n’est qu’un collage de stéréotypes, alors il y a fort à parier que sa réception cultiste est elle-même de l’ordre du dé-collage. Autrement dit, on ne fait pas entrer tout un film dans la mémoire collective, seulement la partie qui est mémorable, manifestement parce qu’elle dépasse la stéréotypie. Eco laissait dans l’ombre le fameux dernier dialogue entre Ilsa et son ancien amant Rick, à l’aéroport, ce dernier déclarant qu’ils ne devaient plus se revoir, qu’elle devait suivre son mari, mais : « We’ll always have Paris », lieu de la romance passée, désormais source inépuisable de nostalgie.
Or, quand la stéréotypie concerne l’art populaire en général, ce point de bascule affectif paraît caractéristique de l’objet culte. Par-delà la stéréotypie, Casablanca est un film sur la guerre qui véhicule une image émouvante de la catastrophe : celle de Paris occupée, perdue, mais encore rêvée. Pas de culte sans cette image. Au reste, le cultisme ne concerne pas seulement l’art populaire. Il est des films culte, des acteurs culte – James Dean, image de la conduite à risque adolescente –, mais il est aussi des penseurs culte. C’est ce qu’on dit par exemple du philosophe Walter Benjamin. La stéréotypie n’est plus guère ici un critère pertinent, remplacé sans doute par l’illisibilité. Si Benjamin est culte, ce n’est pas directement en raison de l’hermétisme de ses écrits, mais parce qu’on y déchiffre le signe ou l’écho de sa destinée tragique : la persécution par les nazis et le suicide à la frontière franco-espagnole.
L’illisible ici, la stéréotypie là apparaissent comme l’indirect – la protection, mais aussi le symptôme – d’un réel fait de terreur et de pitié. Il faut remonter à ce propos aux sources romantiques de l’esthétique postmoderne : Friedrich Schlegel a pensé à l’aube du XIXe siècle la catégorie esthétique de l’ironie, cette position de surplomb que peut adopter l’artiste vis-à-vis de sa création (et des stéréotypes dont elle est composée). Or, Schlegel est aussi l’auteur d’un éloge de l’incompréhensibilité, texte lumineux qui préfigure la théorie freudienne du refoulement. Du roman tel qu’il fut pensé par les romantiques d’Iéna, le film culte est donc un lointain avatar : la manie créatrice, d’aller vers l’inconnu ou d’accumuler le déjà vu, y est ponctuée par le sentiment de la perte, qui cristallise dans l’image de la mélancolie ou de la nostalgie. Et c’est ce punctum qui emporte finalement l’adhésion du public.
C’est dans cette mesure que les films culte ont quelque chose à nous transmettre pour affronter les catastrophes de notre présent ou de notre futur. Avec Interstellar de Christopher Nolan (2014), le cinéma à grand public d’Hollywood, dont on ne cesse de dire l’essoufflement, a produit un objet qui répond certainement encore à cette sensibilité. Dans un futur proche, les ressources naturelles de la Terre s’épuisent (comme les ressources créatives de l’industrie du spectacle). Une équipe d’astronautes se lance alors dans une mission désespérée, trouver pour l’humanité un nouveau monde ailleurs dans l’univers, aidée en cela par la brèche qu’aurait ouverte dans l’espace-temps ce qui ressemble à une civilisation extraterrestre. Le déjà-vu du cinéma de catastrophe et de science-fiction opère ici à plein régime, comme une reconnaissance et comme une anesthésie : non, il ne s’agit pas d’une anticipation des conséquences de la catastrophe écologique dont les journaux nous parlent quotidiennement, mais du recyclage opportuniste de thèmes et de ficelles usés de l’art populaire.
Interstellar n’a pas de message à délivrer autre que stéréotypique sur l’écosystème et l’avenir du monde. Le vrai sujet du film, c’est la parentalité, la temporalité particulière qui lui est inhérente, sa nostalgie immédiate : les enfants grandissent trop vite. Et d’autant plus vite que leurs parents sont des post-adolescents qui veulent avoir plus d’une vie dans leur vie, et donc n’ont guère le temps de s’en occuper : ainsi de Cooper, le héros, au début du film, astronaute reconverti dans l’agriculture mais qui rêve encore de grands espaces, et qui voit dans cette ultime mission la chance de réaliser ses aspirations loin des siens. De ce traumatisme personnel, ou de cette cruauté ordinaire, la séquence la plus célèbre d’Interstellar, celle que l’on trouve le plus aisément sur la toile, constitue l’extension imaginaire et cauchemardesque.
Cette séquence raconte la première excursion effectuée par l’équipe sur une planète située dans une autre galaxie. Cette planète présente la particularité d’être bordée par un trou noir qui ralentit considérablement l’écoulement du temps (une heure y correspond à sept années sur Terre). Malgré leur détermination à faire vite, les astronautes ne parviennent pas à empêcher cette hémorragie de durée : de retour dans leur vaisseau, ils ont perdu vingt-trois années terrestres. Cooper en prend concrètement conscience en visionnant les nombreux messages vidéo stockés par l’ordinateur de bord durant son absence, en voyant le visage de son fils vieillir et s’assombrir de désespoir, en apprenant de sa bouche les naissances et les morts, en écoutant sa fille lui reprocher son départ… Et alors pour le spectateur sincèrement touché par ce pathos, il n’est plus naïf de s’interroger quant à l’avenir de ses enfants.
Parce que le traumatisme y est indirectement évoqué, l’objet culte se prête donc à tous les réinvestissements : on peut y entendre des blessures intimes (la déréliction adolescente dans La Fureur de vivre) autant que de terribles prophéties. Mais cet indirect est aussi sa limite, car rien n’oblige à les y entendre vraiment. L’objet culte n’engage à rien, et s’il engage, c’est sous une forme marginale, à l’instar du stalkerisme. Il n’en permet pas moins une première tentative d’appréhender collectivement la catastrophe.
+ de décryptages du même auteur
Site développé par Polara Studio
