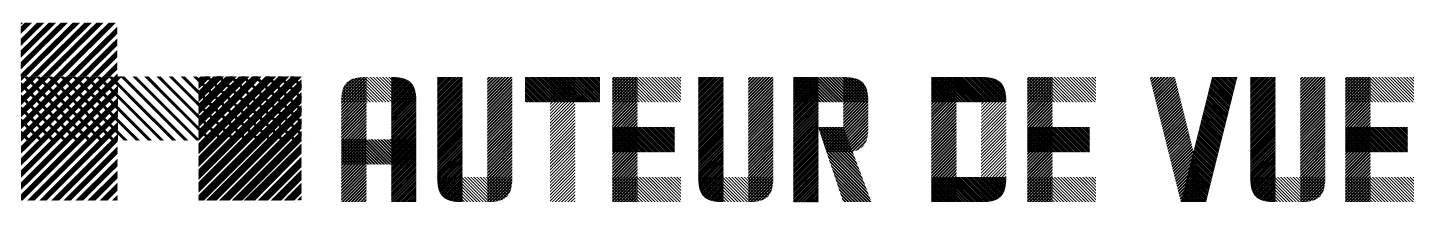
La violence faite aux femmes: analyse d’une «névrose sociale»
publié le 16/03/2020

« Le sujet philosophique, écrit Zola dans ses Carnets à propos de Nana, est celui-ci : toute une société se ruant sur le cul. Une meute derrière une chienne, qui n’est pas en chaleur et qui se moque des chiens qui la suivent. Le poème des désirs du mâle, le grand levier qui remue le monde. Il n’y a que le cul et la religion…». Ce qui intéresse l’écrivain, ce sont les dérèglements de la société sous le Second Empire: une société masculine dévorée d’une part, par un féroce appétit financier (La Curée), et, d’autre part, par un désir sexuel (selon lui, trop longtemps frustré par les valeurs religieuses) devenu irrépressible. C’est là le « sujet » de Nana, qui exprime donc ce que l’on pourrait nommer une « névrose sociale », dont les symptômes sont l’engouement capitaliste et le dévoiement des mœurs. Cette névrose, que Zola décrit sans concession, aboutit à la maltraitance des femmes : les violences faites aux femmes deviennent le symbole des ravages d’une société bourgeoise triomphante mais pourrie en sa racine.
Le parcours de Nana
Fille de Germaine Macquart et d’un père alcoolique, viciée par la naissance, vicieuse par inclinaison, mais bonne envers les humilés, Nana répand le vice par plaisir : « Elle avait poussé dans un faubourg sur le pavé parisien ; et grande, belle de chair superbe ainsi qu’une plante de plein fumier, elle vengeait les gueux et les abandonnés dont elle était le produit». Nana : une femme qui parcourt tous les échelons de la société, des bas-fonds des lupanars jusqu’aux sphères supérieures de l’aristocratie. Une femme qui réinvente tous les rôles : la sordide, la courtisane, l’hétaïre, la mère, la putain. Bref, Nana est le condensé de la femme. Elle est toute la femme.
L’intrigue principale traite de la relation singulière de Nana avec le Comte Muffa, conseiller aulique, au faîte du pouvoir, pétri de religion. Epoux versant dans la relation adultérine avec Nana, il assiste, impuissant et indifférent, à la déchéance de sa propre femme, qui s’abîme elle aussi dans des relations adultérines et qu’il reprendra auprès de lui sans jamais lui prêter attention. Tout commence dans la loge de Nana, à l’ambiance sensuelle: odeurs, pots renversés, crèmes répandues, étoffes éparpillées. Devant la chair de Nana, Muffat, qui n’a pas eu d’adolescence, n’a pas connu la passion amoureuse mais seulement des rapports conjugaux, succombe: « Il s’abandonnait à la force de l’amour et de la foi, dont le double levier soulève le monde. Et toujours, malgré les luttes de sa raison, cette chambre de Nana le frappait de folie, il disparaissait en grelottant dans la toute-puissance du sexe, comme il s’évanouissait devant l’inconnu du vaste ciel. »
Puis, devant le spectacle de la trahison de sa bien-aimée, Muffat parvient à s’arracher de Nana, et cède enfin aux prières du jésuite M. Venot qui n’a cessé de l’accompagner : « La femme le possédait avec le despotisme jaloux d’un Dieu de colère, le terrifiant, lui donnant des secondes de joie aiguës comme des spasmes, pour des heures d’affreux tourments, des visions d’enfer et d’éternels supplices ». Revenu de toutes les déceptions du sexe, le sien et l’autre, il ne reste plus au pêcheur qu’à revivre dans la religion – ce qui lui fut ravi par la seule femme qu’il a aimée, cette fois en se torturant publiquement et non plus dans les alcôves. Magnanime et maternelle, la religion sauve le pêcheur de sa damnation et rédime les péchés de la (haute) société pourvu qu’elle l’affiche devant tous.
De son côté, Nana elle-même entame une lente descente aux enfers : au sortir d’une nuit d’amour, elle se retrouve pétrie d’angoisse à l’idée de la mort et de sa propre charogne. Elle promet alors de se repentir et de brûler des cierges, de fréquenter à nouveau l’église et de se confesser, de retrouver la pureté enfantine. Mais l’héroïne finira par se consumer dans une agonie innommable au fond d’un bouge crasseux.
Le roman s’achève dans l’illusion d’une santé sociale: les apparences sont sauves, les hierarchies sociales sauvegardées ; mais cette sérénité retrouvée n’est que mirage: les hommes peuvent désormais se ruer non plus sur le cul, mais sur ce qui en est le prolongement : la guerre, celle de 1870, qui achève le regime pourri, telle une apothéose barbare.
La dénonciation sociale de l’obscénité
En 1880 en réponse aux critiques qui dénoncent l’obscénité de Nana, l’écrivain répond : « Notre siècle a une longue éducation de pudeur, qui le rend d’autant plus hypocrite que ses vices se sont civilisés davantage. On fait la chose mais on n’en rit plus; on en rougit et on se cache. La morale ayant été mise à dissimuler le sexe, on a déclaré le sexe infâme. Il s’est ainsi formé une bonne tenue publique, des convenances, toute une police sociale qui s’est substituée à l’idée de vertu. Cette évolution a procédé par le silence : il est des choses dont il est devenu peu à peu inconvenant de parler, voilà tout ; de sorte que l’homme distingué, l’honnête homme est celui qui fait ces choses sans en parler, tandis que celui qui en parle sans les faire, comme certains romanciers de ma connaissance, sont traités de gens orduriers et trainés journellement dans le ruisseau »[1].
« Cul et religion », pour reprendre les mots de Zola, la conjonction des deux termes traduit à la fois leur exclusion, chacun s’épanouissant en excluant l’autre, et leur proximité tant il est évident que la jouissance des deux emprunte à l’autre le ressort de son expression. Et c’est parce que les abîmes que chacun désigne sont si proches – la jouissance divine de la chair frôlant l’extase de la jouissance en Dieu –, que chacun est l’ennemi mortel de l’autre.
La religion est acharnement à nier en pleine conscience la chair qui, elle, s’épuise à se vouloir fusion dans une unité pensée comme sacrée. La religion est ascèse dans l’évidemment du sensible poursuivi sans relâche, quand la chair est plénitude dans l’accomplissement continu dans l’autre. Zola reprend ici un thème largement traité depuis la fin du XVIIIe siècle, celui des relations ambigües et perverses entre amour céleste et amour terrestre saisies à la lumière de la culpabilité et de la jouissance dans la faute, le péché et la grandiloquence du rachat. Les journaux satiristes franchissent en toute gaité l’interdit du sacré pour peindre les prostituées crucifiées dans la jouissance et dénoncent à leur manière le mélange des intérêts de l’Église et de l’Etat. Zola, lui, en rajoute dans la dénonciation en plaçant au cœur de son roman la dénonciation d’un masochisme commun à l’amour de Dieu et à l’amour sexuel, pendant d’une culpabilité ravageuse. Epoux, propriétaires, et croyants, les hommes se révèlent incapables de faire face aux exigences qu’ils ont eux-mêmes forgées en se plaçant au sommet de l’édifice de la domination bourgeoise. Et la nature trop longtemps contrainte se venge. Elle se venge notamment en diabolisant la femme, objet du désir et réduite au statut d’objet. C’est du moins ce que révèle l’analyse psychologique de Muffat: « Tout son être se révoltait, la lente possession dont Nana l’envahissait depuis quelque temps l’effrayait, en lui rappelant les lectures de piété, les possessions diaboliques qui avaient bercé son enfance. Il croyait au diable. Nana, confusément, était le diable, avec ses rires, avec sa gorge et sa croupe, gonflées de vice. »
Une leçon pour la société contemporaine
Que les femmes soient victimes de violence est souvent le signe tragique d’un dérèglement social inadmissible. On l’a vu récemment encore, hélas, avec le procès du producteur hollydwoodien Harvey Weinstein et avec le mouvement #MeToo. Ce que Zola nous apprend sur nous-mêmes, c’est que, la plupart du temps, la libération des appétits capitalistiques et ultra-libéraux, l’avidité s’accompagnent de mauvais traitements faits aux femmes, réduites à n’être rien de plus que les objets d’un désir masculin irrépressible.
[1] Nana, édition GF, présentation, notes, dossier, chronologie, bibliographie mise à jour en 2013 par par Marie-Ange Fougère, p.471.
+ de décryptages du même auteur
Site développé par Polara Studio
