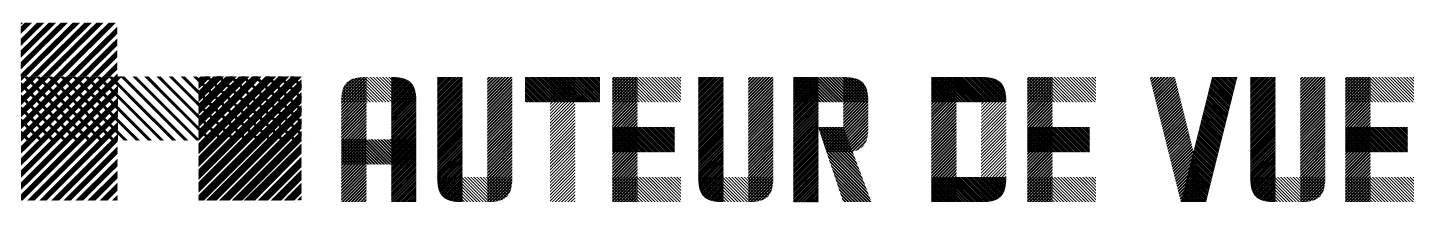
Nouvelles censures
publié le 13/09/2019

Presses universitaires de France / "L'art sous contrôle" de Carole Talon-Hugon
Les années 1965-1966 ont vu le recul spectaculaire de la censure en France : La Religieuse de Rivette ne fut plus poursuivie après son changement de titre ; Malraux refusa de couper la subvention de l’Odéon malgré la campagne de parlementaires contre Les Paravents ; le Marat-Sade de Peter Weiss, dont la presse gagea pourtant qu’il serait interdit, fut épargné de toute entrave ; les derniers volumes de la Bibliothèque Internationale d’Érotologie publiés par Pauvert à partir de 1965 ne connurent pas le sort de leurs prédécesseurs. À Rome, dans la foulée du concile Vatican II, l’Index librorum prohibitorum fut supprimé en juin 1966. Ce soudain reflux de la censure avait de quoi paraître un tournant historique définitif. Mais en a-t-on fini avec la censure ?
Le dernier livre de Carole Talon-Hugon, L’Art sous contrôle. Nouvel agenda sociétal et censures militantes (Paris, Presses Universitaires de France / Humensis, 2019), décortique une nouvelle forme de censure contemporaine, inédite dans ses motifs comme dans ses modes opératoires. L’auteur de la somme Morales de l’art y dresse un état des lieux d’un nouvel art engagé, où dominent le combat LGBT, la cause féministe, la lutte postcoloniale, le drame des migrants, la conscience écologique, ou encore plusieurs de ces préoccupations mêlées dans une perspective « intersectionnelle ».
Cet engouement du côté des créateurs pour les sujets sociétaux s’accompagne aussi d’une nouvelle critique moralisatrice, et même de censures, constate-t-elle. Le musée des Beaux-Arts de Manchester retire ainsi les « Nymphes » de John William Waterhouse, pour remplir l’espace vide d’un écriteau « Comment les œuvres d’art peuvent-elles nous parler d’une façon plus contemporaine et pertinente ? ». Des étudiants de Columbia University se plaignent de la présence d’Ovide dans leur programme ; Gallimard renonce à publier les pamphlets de Céline ; des polémiques et des protestations s’élèvent contre La Case de l’Oncle Tom, Tintin, les Petits Contes nègres pour les enfants des Blancs de Cendrars, La Belle au bois dormant et son baiser non consenti, Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. On pourrait allonger la liste au-delà de la publication du livre de Carole Talon-Hugon paru en avril 2019, avec le blocage manu militari de la mise en scène de Philippe Brunet à la Sorbonne des Suppliantes d’Eschyle, la pétition d’étudiants contre le poème d’André Chénier « L’Oarystis » intégré au corpus de l’agrégation de lettres et accusé de banaliser la culture du viol, ou encore la demande croissante de « trigger warnings » dans les universités américaines.
Assiste-t-on à un retour de balancier après le tournant de 1965-1966 qui a eu raison des censures, reléguées à une forme d’autoritarisme béotien et infantilisant, imperméable à la valeur de l’art ? Voire, sur une plus longue période, à une remise en cause de l’autonomie de l’art ou de sa nature transgressive affirmées dès le xixe siècle par les modernités artistiques ? L’étude de Carole Talon-Hugon y voit une rupture impensée avec l’autonomisation, sans pour autant renouer avec des considérations prémodernes.
Les nouvelles censures ne prennent en effet aucun compte de la valeur esthétique et se fixent seulement sur l’éthique. Elles peuvent entraver la diffusion d’œuvres non pas pour leur contenu intrinsèque mais en raison des comportements immoraux de leur créateur ou d’un acteur, « comme si la malignité de leur conduite personnelle se communiquait à leurs œuvres » (p. 45) : Kevin Spacey, Woody Allen, Roman Polanski, Louis CK, Bertrand Cantat en firent les frais. D’autres exemples viennent à l’esprit, comme la déprogrammation du Voyage au pays sonore ou l’art de la question de Peter Handke prévu sur la scène du Vieux Colombier au début de l’année de 2007, retrait non pas dicté par l’inconvenance de la pièce mais par la présence du dramaturge aux obsèques de Slobodan Milosevic. Autres nouveautés de cette censure : des procès en appropriation culturelle qui dénoncent l’usurpation d’identité ; des censures d’association et d’opinion publique ; de nouveaux modes opératoires : « Le lieu de la censure n’est plus le tribunal, mais les médias : réseaux sociaux, sites internet, journaux ; et ses modus operandi spécifiques sont la pétition, la tribune, la manifestation et le lynchage médiatique » (p. 46).
Cette manie sociétale entraîne des transformations dans l’art lui-même : la valeur esthétique s’efface derrière la valeur éthique, l’œuvre devient un témoignage et l’artiste se mue en une sorte de chercheur en sciences humaines, un déconstructeur de stéréotypes, d’où la place de choix réservée à l’art documentaire, réputé plus efficace pour transformer les mœurs qu’un art trop opaque et nécessitant des dispositifs discursifs en forme de « modes d’emploi » pour servir à la compréhension du sens orthodoxe. Mais à trop jouer la carte de la communication, l’art documentaire ne risque-t-il pas de neutraliser la dimension artistique, comme l’objectait naguère Adorno au réalisme socialiste ?
Philosophe, Carole Talon-Hugon ne se contente pas d’étudier les mutations sur l’art. Elle aborde aussi les conséquences sur l’éthique, et c’est là un point qui différencie aussi cette nouvelle tendance des pratiques antérieures à l’autonomie de l’art. Alors que jadis l’art faisait partie d’un programme moral général attaché à l’humanité entière, on défend aujourd’hui des intérêts catégoriels (sauf la cause écologique). L’éthique court le risque de se dissoudre dans les combats sociétaux, comme la culture de se balkaniser.
Carole Talon-Hugon tire une sonnette d’alarme. La considération accordée à la valeur esthétique ne serait-elle qu’une parenthèse dans l’histoire de l’art, parenthèse qui serait en train de se refermer sous le coup des nouvelles censures ? Il me semble que nous sommes trop contemporains de cette tendance pour en entrevoir les suites avec justesse. Certes, cette moralisation toute récente s’impose avec bruit et fracas, avec une fougue de néophyte sourd à l’art quand il est immoral. Mais par le passé, certaines censures connurent de rapides modérations, comme aux débuts de l’Index librorum prohibitorum qui sévit dans toute la Respublica christiana à partir du xvie siècle. Lorsqu’en 1559 le pape Paul IV promulgua le premier Index romain, y figuraient notamment des noms d’imprimeurs suspects. Un livre pouvait être ainsi interdit de lecture non pas pour son contenu mais seulement en raison de sa provenance ; une telle situation n’est pas sans rappeler les boycotts d’œuvres en raison du « comportement inapproprié » de leur auteur ou d’un acteur, ou encore la censure partielle en 2013 par le tribunal de Bobigny d’une réédition du Salut par les Juifs par la maison d’édition d’Alain Soral, manifestement pas du fait de son contenu (réfutation de Drumont par Bloy) mais de son éditeur. Cependant, après la mort de Paul IV, le cardinal grand inquisiteur Michele Ghislieri édicta en 1561 une Moderatio Indicis librorum prohibitorum qui levait une interdiction aussi excessive. Deux ans plus tard, en 1563, une commission nommée par le concile de Trente fixa dix règles à l’Index, dont celle de ne pas interdire les œuvres obscènes composées dans un langage élégant. C’était accorder à l’art une telle valeur qu’elle primait sur l’immoralité et abolissait l’interdiction, en cela proche de l’autonomie de l’art prônée par les modernes.
Une auto-modération des nouveaux censeurs n’est donc pas à exclure. Et peut-être assiste-t-on moins à un autodafé façon Fahrenheit 451 qu’à un feu de paille que le temps, la raison et le goût éteindront vite. L’essai de Carole Talon-Hugon contribuera à mieux apprécier cette mode artistique et ses postulats tacites. Malgré la galerie des censures exposées, son étude n’est pas submergée d’inquiétude, tant on croit discerner sous l’analyse savante un humour pince-sans-rire.
Site développé par Polara Studio
