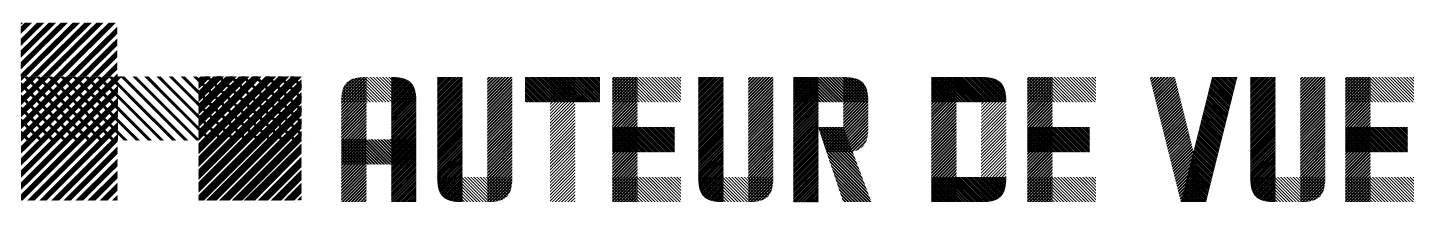
Du pouvoir mélioratif de la fiction
publié le 16/12/2019

Pixabay Books
A l’heure où l’Education Nationale s’informe et consolide ses ambitions autour d’un collège d’experts composé de spécialistes en neurosciences comme Stanislas Dehaene, président du conseil scientifique de l’Éducation nationale, il est difficile de ne pas faire le lien entre éducation, cognition, émotions et coopération. Le liant pourrait être la culture littéraire dont on parvient sans peine à lui trouver les plus grandes vertus. Quelles sont les qualités à mûrir qui feront d’Homo sapiens une espèce encore plus coopérative? Comment lutter contre la tendance contemporaine au tribalisme qui clive, isole et encourage les comportements individualistes? Afin de venir en aide aux plus vulnérables, comment cultiver l’empathie en élargissant sa tendance endogène (au sein d’un même groupe) qui semble plus naturelle qu’un élan affectif pour de parfaits inconnus?
De la dissolution sociale à la coopération
Il y a cinq ans, Richard Sennett tirait le constat de la dissolution sociale qui s’observe « aujourd’hui dans le développement d’une certaine forme de tribalisme, de repli sur sa communauté, ou dans la ségrégation territoriale entre les différentes couches sociales » et plaçait l’empathie au cœur de son projet de société dans Ensemble. Pour une éthique de la coopération (2014). Selon lui, « La sympathie repose sur l’identification. [...] la personne qui fait preuve de sympathie est capable de ressentir toutes sortes d’émotions, même liées à des expériences très éloignées de lui. Au contraire, l’empathie consiste à accueillir le nouveau, et à essayer de l’appréhender sans nécessairement se l’approprier, ou le ramener à un évènement de sa propre histoire. Cela sous-tend d’être capable de naviguer dans une certaine forme d’ambiguïté, de complexité. C’est beaucoup plus riche, mais aussi beaucoup plus difficile ».
Le rôle utilitaire des belles-lettres : la littérature rend plus humain
Depuis ces dix dernières années notamment, de nombreux théoriciens de la littérature (comme Antoine Compagnon, Vincent Jouve, Jean-Marie Schaeffer et Yves Citton) ont interrogé le rôle utilitaire des belles-lettres afin de savoir s'il était pertinent de vouloir donner une finalité à la littérature, sinon un objectif à atteindre. Les études littéraires cognitives, qui se sont développées dans le domaine anglo-saxon depuis les années 1990, quant à elles, n’ont fait que confirmer la conception humaniste de la littérature telle qu’elle était incarnée à la Renaissance par la devise latine humaniores litterae : la littérature rend plus humain.
Il faut entendre le syntagme adjectival « plus humain » comme une valeur ajoutée méliorative et non en tant que valeur absolue : vous n’êtes pas fondamentalement bon uniquement parce que vous lisez les œuvres de Léon Tolstoï, James Baldwin, Simone de Beauvoir, Milan Kundera, John Coetzee, Gustave Flaubert, Toni Morrison ou Honoré de Balzac. Et si vous n’êtes pas friands de cette littérature de haut rang, vous n’avez pas forcément une âme corrompue, cela va sans dire. Qui plus est, se dire que si vous n’aviez pas autant lu, vous seriez devenu un monstre, comme l’a fait Mark O’Connell, est un constat caricatural qui n’apporte rien au débat. Donc, il est inutile de forcer le trait car la fiction, comme Antoine Compagnon suggère à bon droit, n’a pas « l’exclusivité de l’éveil de la conscience morale pour ajuster nos actions et faire de nous des êtres bons. Les piètres lecteurs ne sont donc pas forcément de moins bons humains, bien sûr. »
Avec l’ombre d’un doute
Cela dit, le doute est permis et l’on peut se montrer sceptique vis-à-vis de la proposition selon laquelle la littérature nous rendrait meilleurs. Gregory Currie va jusqu’à renverser cette affirmation : « Mais pouvez-vous être sûr que cet ami si intelligent, généreux, attentif aux autres et qui lit Proust est devenu cet homme-là en partie à cause de ses lectures ? Est-ce que ce ne pourrait pas être le contraire ? Que les gens brillants, compréhensifs et socialement compétents aient plus d’inclination que les autres à goûter les tableaux complexes des interactions humaines que l’on trouve dans la littérature ». S’il n’est donc pas certain que la fiction ait des vertus civilisatrices, il est néanmoins avéré que la lecture de ces intrigues fictionnelles d’une grande complexité psychologique accroît de manière non négligeable la valeur cognitive de la littérature et stimule le circuit de notre cerveau social. La région spécifique se loge dans « le cortex frontal antérieur et dans ce qu’on appelle la jonction tempo-pariétale de l’hémisphère droit » (Stanislas Dehaene in La plus belle histoire de l’intelligence. Des origines aux neurones artificiels : vers une nouvelle étape de l’évolution).
Les pouvoirs immatériels de la fiction littéraire
A en croire les résultats obtenus par Castano et Kidd, on compte parmi les pouvoirs immatériels de la fiction littéraire (celle que ces deux auteurs opposent à la littérature de gare) la capacité d’améliorer son comportement en société par le perfectionnement de la théorie de l’esprit. Keith Oatley, romancier et éminent spécialiste de psychologie cognitive, avance l’idée selon laquelle la lecture attentive de fiction développerait l’intelligence empathique : « les gens qui lisent souvent des fictions écrites semblent mieux à même d’éprouver de l’empathie, de comprendre les autres et de se mettre à leur place ». Pour Antoine Compagnon, « la littérature a ceci d’irremplaçable qu’elle contribue à l’éthique pratique par l’expérience provoquée chez le lecteur qui pénètre dans un monde nouveau, étranger, et part à la découverte de l’autre. Elle nous rend donc surtout plus vaste. »
Deux logiques concomitantes
La question selon laquelle la littérature aurait un pouvoir mélioratif sur les lecteurs en leur donnant de la valeur ajoutée répond, me semble-t-il, essentiellement à deux logiques : la première, capitaliste, souhaite vouloir donner un rôle utilitaire à toute chose, y compris à un domaine comme la littérature et les plaisirs esthétiques que l’on a longtemps promus à des fins non pratiques. La seconde, sanitaire, suit cette mouvance du bien-être qui, depuis quelques années, inonde les consommateurs de bons conseils pour une vie meilleure. Dans Les livres prennent soin de nous, Régine Detambel souhaite nous convaincre des maintes vertus des livres et de la lecture, au-delà des capacités cognitives qu’on leur prête d’ordinaire. Les œuvres auraient ainsi un pouvoir mélioratif sur la santé mentale, un pouvoir réparateur et consolateur, voire un effet anxiolytique. Elles auraient aussi des vertus roboratives, sinon anti-dépressives et sécurisantes.
Sur de nombreux forums de santé, avec une kyrielle d’études en neurosciences et sciences cognitives à l’appui, il n’est pas rare que l’on nous exhorte à lire de la fiction ! Cela réduirait le stress, améliorait le sommeil, ferait travailler l’esprit et retarderait le déclin cognitif… En somme, la lecture de livres de fiction, forte de sa richesse d’évocation émotive, rendrait plus heureux. Alors pourquoi attendre ? puisque la science vous le dit !
Site développé par Polara Studio
