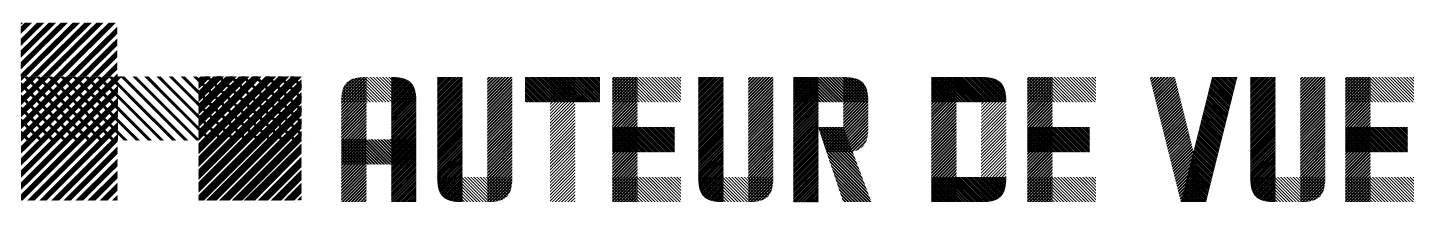
DE L’ARBRE À L’HOMME : RÉINTERROGER L’INTELLIGENCE DE LA NATURE
publié le 28/04/2020

© M.-W. DEBONO, CHAMP DE TABAC, VIÑALES, LA HAVANE, 2018.
Parmi les sciences de la vie, il en est une, récemment apparue, la neurobiologie végétale qui ne cesse de provoquer des questionnements sur le modus vivendi d’êtres dépourvus de cerveau, mais présentant des signes d’intelligence : les plantes. Cette initiative avance, sur la base d’observations fonctionnelles et comportementales (systèmes de perception évolués, présence d’hormones, de réseaux bioélectriques à longue distance, d’analogues de neurotransmetteurs et de terminaisons synaptiques au niveau des apex racinaires, capacités de mémorisation et d’apprentissage, stratégies de communication et de défense étendues..) que les végétaux sont beaucoup plus proches du règne animal ou humain qu’on le pensait.
Bien que controversée dans sa formulation, et aujourd’hui principalement réorientée vers l’étude de la signalisation cellulaire et des comportements, les principaux acteurs de ce courant de pensée (Mancuso, Baluska, Trevawas) ont réussi leur pari, dans le sens où ce champ expérimental a donné lieu à des centaines de publications allant de la botanique et la biologie végétale à de nouvelles formes d’éthologies, en passant par l’ethnobotanique, ou encore l’agro-écologie. Quelle que soit l’interprétation donnée à ces résultats, très différents en nature, et butant tous sur un problème de sémantique, une émulation sans pareille s’est emparée du monde scientifique et une moisson de découvertes en a découlé sur presque deux décennies, aussi étonnantes les unes que les autres.
Elles concernent la dimension électrique de la vie, les processus de communication interespèces, l’expression de gènes codant spécifiquement pour un caractère donné ou l’observation de modulations de patterns non purement adaptatifs (plasticité développementale). Ainsi, ces orchidées mimant le sexe d’un insecte pour se faire butiner par ses prédateurs, ce maïs qui émet des odeurs afin d’inciter les guêpes à pondre leur œufs dans les chenilles d’insectes qui mangent ses propres feuilles, ces plantes ordinaires, comme l'Arabette des dames, capables de proprioception, ou plus rares, comme la sensitive (Mimosa pudica) et les plantes carnivores, capables de mouvements rapides et de mémorisation. A cela s’ajoute un immense réseau de communication mycorhizien analogue à notre internet ou encore les nombreux mécanismes de défense (sous forme d’émission de tanins ou de composés volatiles délivrés de façon proportionnée aux attaques d’herbivores) pouvant se transmettre aux espèces voisines, voire mettant en place de façon préventive ces mécanismes si l’un de leurs congénères est menacé (chez les ormes par exemple).
Face à ce tableau évoquant une intelligence des plantes, dont les interprétations vont aux deux extrêmes de la description de simples tropismes à l’évocation d’une potentielle conscience des plantes, la science occidentale, incluant des botanistes comme F. Hallé, des biologistes, des géographes, des biosémioticiens, des paysagistes ou des écologues, semble unanimement admettre être face à un peu plus qu’à un problème purement métaphorique et redécouvrir la sensibilité extrême comme les capacités de communication insoupçonnées de plantes considérées, encore il y a peu, comme éléments de paysage, outils agricoles ou simples produits de consommation. En somme, on passe de la description, sinon d’objets, d’organismes vivants passifs et soumis à un environnement fluctuant, à celle de sujets hautement réactifs à leur milieu immédiat (au sens mésologique du terme), ce qui constitue subrepticement un véritable changement de paradigme à l’heure de l’Anthropocène (voir ouvrage publié chez Hermann en 2018).
Parallèlement, le grand public, sensibilisé par la crise climatique, la perte de la biodiversité, la cause écologique et une réactivité marquée liée aux pratiques végétariennes ou végane, est rapidement captivé et mobilisé face à des découvertes surmédiatisées comme l’affaire des acacias tueurs de koudous (Wouter) ou les affirmations de certains auteurs médiatiques n’hésitant pas à humaniser les plantes en parlant d’elles à la première personne ou en leur prêtant des émotions et de l’intentionnalité (Wohlleben, Hall, Van Cauwelaert, Backster). Or, si la question de l’intelligence des plantes est parfaitement légitime, eu égard aux facultés étonnantes des plantes, elle dépasse largement la quête scientifique. En effet, les réponses données jusqu’à présent par la majorité des auteurs, sont soit résolument tournées vers la description « d’une plante neuronale », soit vers celle « d’une plante ésotérique », avec tous les degrés intermédiaires que comportent ces deux acceptions. Ce à quoi s’ajoute la dénonciation du caractère anthropomorphe ou zoocentrique de ces approches, autrement dit notre tendance à nous approprier tout ce qui relève d’une intellection, et les dérives sémantiques possibles de la notion d’intelligence, sans pour autant trouver de consensus ou proposer d’alternative acceptée par tous.
Il s’agit donc de prendre du recul et de contextualiser précisément cette question de l’intelligence végétale en adoptant une vision véritablement transdisciplinaire qui interroge aussi bien l’histoire des mythes, de la botanique et de la philosophie, que l’anthropologie, l’éthique, l’écologie, la métaphysique, l’art et l’épistémologie. Et cela conduit tout un pan de la recherche à étudier la nature cognitive des plantes en tentant de répondre à la question « pourquoi tout cela est-il possible sans cerveau ? » comme leur capacité à interpréter directement les signaux du milieu, tandis que d’autres chercheurs mettre l’accent sur l’altérité propre aux plantes.
Plus généralement, il s’agit de reconsidérer le monde du sensible et sa perception par les organismes non humains ou animaux dans un monde saturé d’informations et de plus en plus urbanisé. Hormis les nombreux ouvrages philosophiques ou anthropologiques s’interrogeant sur la dégradation des liens entre nature et culture ou sur le statut végétal (Descola, Morin, Marder, Hall,…), de nombreux écologues comme Tsing, Myers, Edwards ou Margulis demandent en effet une révision urgente du statut de l’écologie scientifique, dû au fait qu’elle base essentiellement ses actions sur des modélisations et des simulations à l’échelle planétaire, notamment liées au réchauffement climatique et à ses conséquences économiques (cycles globaux du carbone), certes utiles, mais qui coupent l’homme de la nature.
Jacques Tassin dans son dernier ouvrage sur l’écologie du monde sensible (O. Jacob, 2020) lance un cri d’alerte dans ce sens en indiquant que les données liées à la sensibilité sont écartées par la recherche en écologie au profit du traitement unilatéral des informations à l’échelle des populations ou des territoires, d’une mécanisation et d’une quantification à outrance du vivant conduisant à « monnayer la biodiversité ». Des décisions abusives pouvant aller à l’encontre des végétaux sont prises, comme par exemple des arrêtés de déforestation massive au Canada sous prétexte que les jeunes arbres replantés seraient de meilleurs capteurs de carbone atmosphérique, la mise en place de monocultures industrielles ou l’accusation de végétaux considérés comme ne pouvant potentiellement plus jouer leur rôle sur le plan carbonique du fait de leur vulnérabilité accrue aux herbivores et aux incendies.
Outre le fait que ces attitudes soient un non-sens en lien direct avec le ‘Capitalocène’ (Haraway) et qu’elle posent la question éthique du droit des plantes (Côté-Boudreau), en parallèle de celle liée à la conscience des animaux (tout juste sortis du statut d’objet: Pouydebat), ce sont les hommes, urbanisés à outrance et de plus en plus ancrés dans une réalité virtuelle, qui sont les premières victimes de cette déterrestration. Or, c’est précisément de la question de l’écosensibilité du monde et du rapport de connivence entre l’arbre et l’homme qu’il s’agit ici, et non pas de juger de la pression de l’environnement ou de la latitude de réaction de telle ou telle population de plantes face à un stress hydrique ou à un prédateur.
En conclusion, on voit dans cette tribune comment une question purement scientifique touchant à l’évolution des systèmes vivants et à la divergence des règnes dérive sur des problèmes de société concernant la biosphère et la mémoire de la vie. Il y a donc urgence à réinterroger l’intelligence de la nature, à végétaliser le monde et à reterrestrer l’humain !
Site développé par Polara Studio
